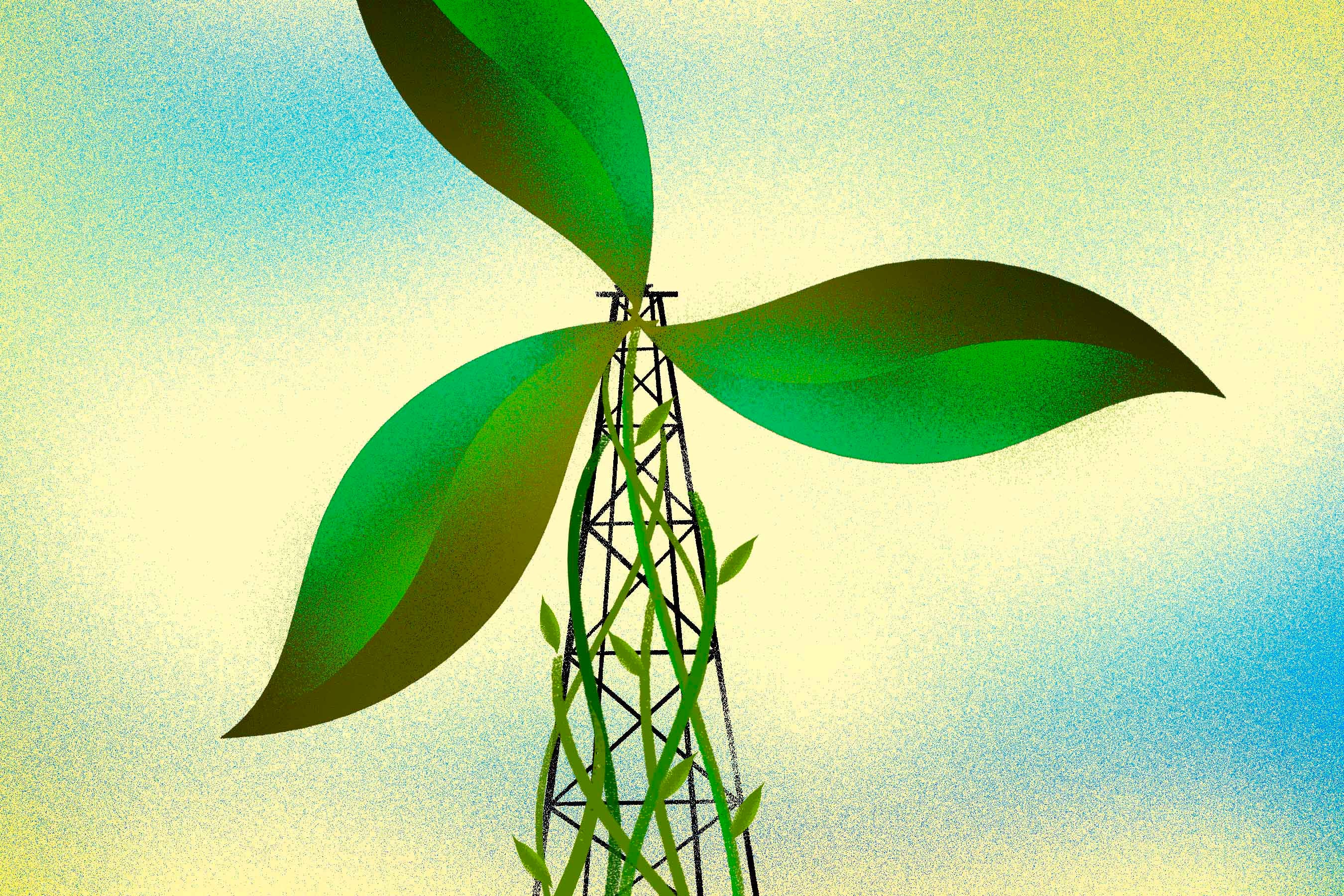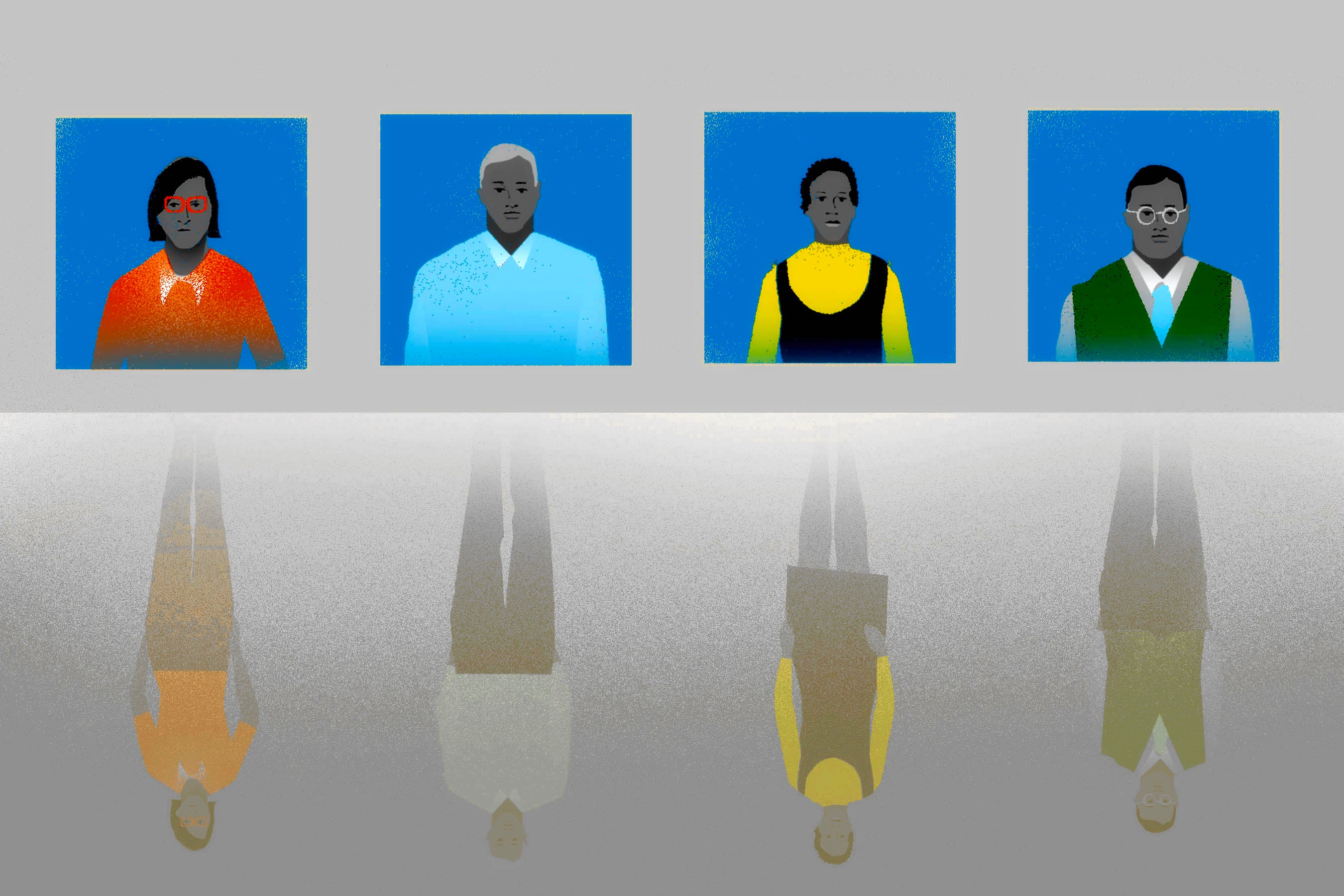Le Maroc a intensifié sa répression contre des commentateurs des réseaux sociaux, des artistes et des journalistes exprimant des opinions critiques à l’égard de la monarchie. Bien que le code de la presse ne prévoie pas de peine de prison pour sanctionner des critiques, les autorités continuent de recourir à certains articles du code pénal pour emprisonner des détracteurs. Avant même que les manifestations et les réunions publiques ne soient interdites afin de contenir la propagation du virus Covid-19, les autorités avaient déjà interdit plusieurs réunions publiques des groupes d’opposition et continué d’entraver les activités de certaines organisations de défense des droits humains. Des lois qui restreignent l’exercice des libertés individuelles sont restées en vigueur.
Système judiciaire pénal
Le Code de procédure pénale donne à un prévenu le droit de contacter un avocat au bout de 24 heures de garde à vue dans les locaux de la police, période qui peut être allongée jusqu’à 36 heures. Mais les détenus n’ont pas droit à la présence d’un avocat lors de leurs interrogatoires par la police ou lorsque celle-ci leur présente leur déposition à signer. Il est fréquent que les agents de police contraignent les détenus, par divers moyens de pression, à signer des déclarations auto-incriminantes, sur lesquelles les juges s’appuient par la suite pour les condamner.
Dans les prisons, certains détenus de renom ont été gardés à vue au secret 23 heures par jour et donc privés de contacts avec les autres détenus, ce qui constitue un traitement cruel et une violation des normes internationales. Abdelqader Belliraj, un citoyen possédant une double nationalité marocaine et belge, condamné en 2009, à l’issue d’un procès inéquitable, à la prison à perpétuité pour complot en vue de commettre des actes terroristes, a été détenu dans des conditions semblables pendant trois ans, de 2017 jusqu’à août 2020, selon ses proches.
Liberté d’association et de réunion
Les autorités ont continué d’entraver le travail de l’Association marocaine des droits de l’homme (AMDH), la plus grande organisation de défense des droits humains du pays. L’AMDH a affirmé qu’à fin septembre 2020, 79 de ses 99 antennes locales étaient confrontées à une situation où les autorités avaient refusé de s’occuper de leurs formalités administratives, ce qui limitait leur capacité à effectuer certaines démarches comme l’ouverture de nouveaux comptes en banque ou la location d’espaces.
Selon l’AMDH, les autorités ont interdit, en janvier et février, au moins 13 réunions, manifestations et autres événements publics prévus par les groupes ou partis d’opposition dans tout le pays.
En mars, les autorités ont interdit les manifestations publiques, dans le cadre d’un paquet de mesures visant à contenir la propagation du virus Covid-19.
Liberté d’expression
Ces dernières années, le Maroc a arrêté, poursuivi en justice et emprisonné plusieurs activistes et journalistes indépendants sur la base de chefs d’accusation douteux, tels que la conduite de relations sexuelles hors mariage. Certains de ces procès ont semblé être motivés par des considérations politiques ou se sont déroulés sans que la régularité des procédures soit garantie à toutes les parties.
Le 29 juillet, un journaliste bien connu et activiste des droits humains, Omar Radi, dont le téléphone portable avait été précédemment infecté par un logiciel espion auquel seuls les gouvernements ont accès, a été arrêté sous une série d’accusations comprenant espionnage, atteinte à la sûreté extérieure et intérieure de l’État, ivresse publique et fraude fiscale. Les deux premiers chefs d’accusation, qui découlent de son activité de journaliste et chercheur, semblent reposer sur des indices très ténus. Le même dossier judiciaire instruit contre lui contient également une accusation de viol formulée par une collègue de Radi. Ce dernier dément l’accusation et affirme que le rapport sexuel était consensuel. Son accusatrice, qui s’est exprimée publiquement, a le droit d’être entendue et respectée et, tout comme Radi, a droit à des procédures judiciaires équitables. Un juge a rejeté la demande de liberté provisoire de Radi. Au moment de la publication de ce rapport, il était toujours détenu et soumis à une enquête judiciaire qui pourrait durer jusqu’à un an.
Le 16 juillet, un collectif de 110 journalistes marocains a dénoncé une poignée de sites internet d’information qu’ils ont qualifiés de « médias de la calomnie » à cause de leurs attaques incessantes et apparemment coordonnées contre les journalistes, activistes et artistes marocains qui critiquent les autorités. Connus pour être proches des services de sécurité, ces sites internet ont publié ces dernières années des centaines d’articles, comprenant des informations privées, sur des individus ciblés.
Parmi ces informations privées figuraient des enregistrements d’actes sexuels, des relevés bancaires et de propriété, des captures d’écran de conversations électroniques privées, des allégations relatives à des relations sexuelles (ou des menaces de rendre publiques ces relations), les identités de co-locataires, ainsi que des détails biographiques, remontant parfois jusqu’à leur enfance, concernant les personnes ciblées, comprenant même des informations sur leurs parents.
Entre septembre 2019 et janvier 2020, les autorités ont arrêté et poursuivi en justice au moins 10 activistes, artistes, étudiants ou autres citoyens dans différentes villes, pour leurs commentaires critiques mais non violents des autorités exprimés par des affichages sur Facebook, dans des vidéos sur YouTube et via des chansons de rap. Ils ont été condamnés à des peines de prison pour des chefs d’inculpation tels que d’avoir fait preuve d’un « manque de respect dû au roi », « offense aux institutions de l’État » et « outrage envers des fonctionnaires publics ».
Les autorités ont poursuivi les auteurs de ces délits d’expression, non pas en vertu du Code de la presse et de l’édition, mais en vertu du Code pénal. Celui-ci, contrairement au Code de la presse et de l’édition, punit de peines de prison les auteurs d’infractions relevant du discours non violent, notamment de propos « portant atteinte » à l’Islam ou à la monarchie et « incitant à s’opposer » à « l’intégrité territoriale » du Maroc, une référence à sa revendication de souveraineté sur le Sahara occidental.
Le 18 février, une cour d’appel de Settat, au sud de Rabat, la capitale, a confirmé une peine de quatre ans de prison prononcée par un tribunal de première instance à l’encontre de Mohamed Sekkaki, un commentateur populaire sur YouTube âgé de 30 ans et surnommé « Moul Kaskita » (« L’homme à la casquette»). Pour avoir diffusé une vidéo critiquant le roi Mohammed VI, il a été accusé d’« offense aux institutions de l’État » et de « manque de respect dû au roi ».
Le 15 juillet, une cour d’appel de Khemisset, à l’est de Rabat, a confirmé une peine de trois ans de prison prononcée par un tribunal de première instance à l’encontre de Mohamed Ben Boudouh, un commentateur sur Facebook surnommé « Moul Hanout » (« Le petit commerçant »), et de Youssef Moujahid, un employé de banque, qui ont créé une chaîne YouTube sur laquelle ils publient des vidéos de commentaire sur les affaires marocaines. Les deux hommes ont été accusés d’« offense aux institutions constitutionnelles [et] outrage à fonctionnaire public », Ben Boudouh parce qu’il a publié une vidéo sur Facebook dans laquelle il critiquait le style de vie fastueux du roi Mohammed VI, et Moujahid pour avoir publié des extraits de cette vidéo sur sa chaîne.
Le 10 septembre, une cour d’appel de Tétouan a confirmé une peine de deux ans de prison prononcée par un tribunal de première instance à l’encontre de Saïd Chakour, un travailleur journalier âgé de 23 ans, pour « outrage à fonctionnaires publics ». Un mois auparavant, parce qu’il estimait avoir reçu une attention et des soins inadéquats dans un hôpital public après avoir été victime d’un accident de la circulation, Chakour était apparu dans une vidéo sur YouTube, insultant le personnel de l’hôpital et les responsables marocains en général, y compris le roi Mohammed VI.
Sahara occidental
Le processus de négociations sous l’égide des Nations Unies entre le Maroc et le Front Polisario, le mouvement de libération qui lutte pour l’auto-détermination du Sahara occidental, territoire dont la plus large part se trouve de facto sous contrôle marocain, est resté suspendu après la démission en mai 2019 du représentant spécial du secrétaire général de l’ONU pour cette région, Horst Köhler. Ce dernier n’avait pas encore été remplacé au moment de la rédaction de ce rapport. Le Maroc propose pour le Sahara occidental une certaine dose d’autonomie sous souveraineté marocaine mais rejette l’idée d’un référendum sur l’indépendance, que les parties au conflit avaient pourtant acceptée dans le contexte d’un accord de cessez-le-feu conclu sous l’égide de l’ONU en 1991.
Les autorités marocaines empêchent systématiquement la tenue au Sahara occidental de réunions de soutien à l’auto-détermination sahraouie, font obstruction au travail de certaines organisations non gouvernementales de défense des droits humains, notamment en bloquant leur accréditation et, occasionnellement, passent à tabac des activistes et des journalistes en garde à vue ou dans les rues.
Le 29 septembre, en réponse à la création de l’« Instance sahraouie contre l’occupation marocaine », une nouvelle organisation pro-indépendance, par une activiste bien connue, Aminatou Haidar, entre autres, un procureur d’El-Ayoun a publié un communiqué annonçant l’ouverture d’une enquête judiciaire pour « activités (visant à) porter atteinte à l’intégrité territoriale du royaume. » Le même jour, la police a encerclé les domiciles de cinq membres de ce nouveau groupe, dont Aminatou Haidar. L’un d’eux a déclaré le 5 octobre à Human Rights Watch qu’ils étaient suivis par des véhicules de police dès qu’ils quittaient leur domicile pour quelque raison que ce soit et que l’accès à leurs domiciles était interdit aux visiteurs.
Walid El Batal, un activiste sahraoui favorable à l’auto-détermination, demeure en prison après avoir été condamné en octobre 2019 par une Cour d’appel d’El-Ayoun, chef-lieu du Sahara occidental, à deux ans de prison pour « rébellion » et insultes envers des agents de police. Le 25 février, les autorités ont affirmé à Human Rights Watch qu’elles avaient ouvert une enquête à la suite de la publication sur YouTube, neuf mois plus tôt, d’une vidéo montrant des agents de police passant sévèrement à tabac El Batal et une autre personne au moment de leur arrestation. Les éléments de cette enquête n’avaient pas été rendus publics au moment de la rédaction de ce rapport, quoique les autorités ont affirmé à Human Rights Watch que des tribunaux siégeant à Smara et à El-Ayoun avaient ouvert des enquêtes ou des poursuites à l’encontre de six agents de police pour recours illégal à la violence, en rapport avec l’arrestation d’El Batal. Human Rights Watch n’a pas été en mesure de vérifier cette information de manière indépendante.
En 2020, 19 Sahraouis étaient toujours en prison après avoir été condamnés en 2013 et 2017, à l’issue de procès inéquitables, pour les meurtres de 11 membres des forces de sécurité commis en 2010, lors d’affrontements survenus quand les autorités ont démantelé par la force un vaste cantonnement de protestataires à Gdeim Izik, au Sahara occidental. Dans leur verdict de culpabilité, les deux tribunaux se sont appuyés presque entièrement sur les aveux obtenus par la police, sans enquêter sérieusement sur les affirmations selon lesquelles les deux accusés avaient signé leurs aveux sous la torture. Le 25 novembre, la Cour de Cassation, plus haute instance juridique du Maroc, a confirmé le verdict de la Cour d’appel.
Droits des femmes et des filles
Le Code de la famille marocain est discriminatoire à l’égard des femmes en ce qui concerne les questions d’héritage et les procédures de divorce. Le code fixe à 18 ans l’âge minimum requis pour le mariage, mais autorise les juges à accorder des « exemptions » pour permettre le mariage de filles âgées de 15 à 18 ans à la demande de leur famille. En 2018, 40 000 exemptions de ce type ont été accordées, totalisant près de 20% des mariages enregistrés pendant l’année, ce que le ministre de la Justice d’alors, Mohamed Aujjar, a qualifié d’« augmentation alarmante ».
Quoique la Loi marocaine de 2018 sur les violences faites aux femmes considère comme un crime certaines formes de violence conjugale, crée des mesures de prévention et fournisse de nouvelles protections aux victimes survivantes, elle exige des victimes qu’elles engagent des poursuites criminelles afin d’obtenir ces protections, ce que peu d’entre elles sont en mesure de faire. La loi n’établit pas les devoirs de la police, des procureurs et des juges d’instruction dans les cas de violence conjugale, et ne prévoit pas non plus de financement pour les refuges pour femmes battues. Les organisations de défense des droits des femmes ont mis en garde contre les risques d’une augmentation des cas de violence conjugale lors des périodes de restriction de mouvements dues au Covid-19, et ont appelé à la mise en place d’urgence par les autorités d’un plan pour y répondre efficacement. Ces organisations ont fait état d’une hausse des cas de violence conjugale lors des mois de confinement, tandis que les autorités ont noté que le nombre de plaintes déposées auprès d’elles et de procédures judiciaires a diminué lors de la même période.
Les femmes du Maroc ont revigoré leur propre mouvement #MeToo. Le collectif Masaktach (« Je ne me tairai pas ») a publié des dizaines de témoignages anonymes de femmes dénonçant des violences sexuelles et a connecté des femmes entre elles lorsqu’elles accusaient le même agresseur. La loi marocaine ne considère pas explicitement comme un crime le viol par le conjoint, et les femmes qui dénoncent un viol peuvent se retrouver elles-mêmes poursuivies pour avoir eu un rapport sexuel hors mariage si les autorités ne la croient pas.
Un autre mouvement en ligne, Diha F’Rassek (« Occupez-vous de vos affaires »), a été lancé pour lutter contre les dizaines de comptes de « pornographie revancharde » apparus en ligne pendant la période de confinement du pays due au coronavirus. Ses fondatrices ont indiqué que 300 femmes et filles les avaient contactées pour dénoncer des cas de harcèlement en ligne.
Travailleuses et travailleurs domestiques
Une loi entrée en vigueur en 2018 fournit certaines protections aux travailleuses et travailleurs domestiques, notamment l’obligation pour les employeurs de leur offrir un contrat de travail et des jours de congé, un âge minimum d’embauche et les garanties d’un salaire minimum et d’un plafonnement du nombre des heures de travail. Cette loi impose des amendes aux employeurs qui violent la loi et des peines de prison pour certains récidivistes. Toutefois, le gouvernement n’a pas fait d’efforts notables de communication pour s’assurer que les citoyens, notamment les travailleuses domestiques et leurs employeurs, soient au courant de l’existence de cette loi. Lors du confinement dû au Covid-19, certaines travailleuses domestiques se sont trouvées piégées dans la maison de leur employeur, surchargées de travail et dans l’impossibilité de retourner dans leur famille, selon des informations parues dans les médias.
Droit au respect de la vie privée et à l’orientation sexuelle
Les relations sexuelles consensuelles entre adultes non mariés l’un à l’autre sont passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à un an de prison. La loi marocaine criminalise aussi ce qu’elle qualifie d’actes de « déviance sexuelle » entre personnes du même sexe, expression que les autorités utilisent en référence à l’homosexualité en général, et les rend passibles d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à trois ans.
En avril, des individus ont mené une campagne de harcèlement en ligne visant des hommes présumés homosexuels et bisexuels. Des activistes marocains des droits des personnes LGBT ont affirmé à Human Rights Watch que cette campagne, visant à « débusquer » les homosexuels, avait conduit certaines familles à expulser de leur domicile des hommes présumés homosexuels. Elle a semé la panique parmi des personnes qui cherchaient à protéger leur vie privée à cause de l’ostracisme social envers l’homosexualité et de l’illégalité des rapports entre personnes de même sexe.
Dans un mémorandum publié en octobre 2019, le Conseil national des droits de l’homme marocain, organe dont les membres sont nommés par l’État, a recommandé de décriminaliser les relations sexuelles consensuelles entre adultes non mariés. Plus de 25 organisations non gouvernementales ont exprimé leur soutien à cette recommandation. Toutefois, le gouvernement marocain n’a pas agi en conséquence.
Réfugiés et demandeurs d’asile
Le gouvernement n’a toujours pas approuvé un projet de loi qui constituerait la première législation du Maroc sur le droit d’asile, introduit en 2013. Jusqu’à fin août 2020, le ministère des Affaires étrangères avait accordé, ou avait entamé le processus administratif en vue d’accorder, des cartes de réfugié, accompagnées de permis de séjour spéciaux et d’autorisations de travail, à 812 personnes, pour la plupart originaires d’Afrique sub-saharienne, qui avaient été reconnues par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Les 7 561 personnes reconnues comme réfugiées par le HCR depuis 2007 ont accès à l’enseignement et aux services de santé publics, mais seulement la moitié environ d’entre elles disposent d’un permis de séjour régulier et d’une autorisation de travailler, selon le HCR.
---------------
Tweets
Chapitre #Maroc dans le Rapport mondial 2021 https://t.co/IhRjiRQquZ #Droits2021
— HRW en français (@hrw_fr) January 17, 2021