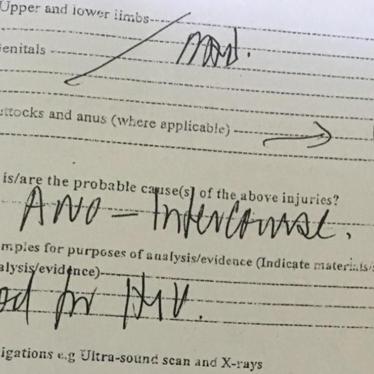(Tunis) – Les autorités algériennes devraient immédiatement libérer Slimane Bouhafs, un militant algérien qui a disparu il y a un an en Tunisie et qui est maintenant détenu dans l’attente des conclusions d’une enquête menée par un tribunal algérien, et faire en sorte qu’il soit libre de quitter le pays s’il le souhaite, ont déclaré Amnesty International et Human Rights Watch aujourd’hui.
Slimane Bouhafs vivait en Tunisie en tant que réfugié. Après avoir « disparu » pendant plusieurs jours, il est réapparu en détention aux mains de la police algérienne, dans des circonstances peu claires. Les autorités tunisiennes devraient enquêter sur ce qui semble avoir été son enlèvement et son retour forcé en Algérie, et amener les responsables présumés à rendre des comptes.
« Slimane Bouhafs a fui l’Algérie après avoir été persécuté par les autorités, et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés lui a accordé une protection internationale en Tunisie », a déclaré Amna Guellali, directrice adjointe pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à Amnesty International. « Le dernier endroit où il devrait se trouver est de retour dans une prison algérienne, risquant un procès. »
Le 25 août 2021, des hommes en civil non identifiés se sont présentés au domicile de Slimane Bouhafs à Tunis, l’ont forcé à monter à bord d’un véhicule et sont partis, a indiqué sa famille d’après des informations recueillies auprès de témoins. Le 1er septembre 2021, Slimane Bouhafs a comparu devant un tribunal algérien, où un juge a ouvert une information judiciaire contre lui en raison de liens présumés avec le Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK), organisation considérée comme terroriste par l’Algérie, et de publications sur Facebook, dans un contexte où le militantisme pacifique fait de plus en plus souvent l’objet de poursuites pénales. Les autorités algériennes avaient auparavant emprisonné Bouhafs pendant deux ans pour des publications sur Facebook jugés insultantes envers l’islam.
Slimane Bouhafs, âgé de 55 ans, est un militant amazigh (berbère) et un chrétien converti. En 2016, un tribunal algérien l’a condamné à trois ans d’emprisonnement au titre de l’article 144 bis 2 du Code pénal, qui rend passible de poursuites le fait d’insulter le prophète Mahomet ou de dénigrer l’islam. Selon ses proches, Slimane Bouhafs a subi des mauvais traitements en prison. En 2018, il a été libéré dans le cadre d’une grâce présidentielle, est parti en Tunisie et a déposé une demande d’asile auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).
Dans une lettre de soutien que la famille de Slimane Bouhafs a partagée avec Human Rights Watch et Amnesty International, une organisation algérienne de défense des droits humains indique qu’il craignait que la justice algérienne ne le poursuive à nouveau en représailles à son militantisme. Slimane Bouhafs a obtenu le statut de réfugié en 2020 en vertu d’un accord entre le HCR et les autorités tunisiennes.
Ses proches ont rapporté, en citant sa version des faits, que les hommes qui l’ont enlevé ont placé un sac sur sa tête, qu’il a été conduit en voiture jusqu’à un poste de police à Alger et que ses ravisseurs l’ont menacé pendant le trajet.
Pendant quatre jours, les membres de sa famille ont ignoré où il se trouvait. Le 29 août, ils ont appris par des sources non officielles qu’il se trouvait en garde à vue dans un poste de police d’Alger.
Le 1er septembre, un juge d’instruction du tribunal de première instance de Sidi M’hamed, à Alger, a ordonné que Slimane Bouhafs soit placé en détention pendant la durée de l’enquête portant sur 10 chefs d’inculpation au titre du Code pénal algérien. Il est notamment poursuivi pour « adhésion à une organisation terroriste » (article 87 bis 3), « apologie du terrorisme » (article 87 bis 4), « atteinte à l’intégrité du territoire national » (article 79), « offense au prophète [de l’islam] » (article 144 bis 2), « publication de fausses nouvelles » (article 196 bis), « incitation à la haine et à la discrimination raciale » (article 295 bis) et « obtention de fonds étrangers » (article 95 bis), selon les informations fournies par les avocats de Slimane Bouhafs, et que sa famille a communiquées à Human Rights Watch et Amnesty International.
Le 20 septembre 2021, des experts indépendants spécialistes des droits humains au sein des Nations Unies ont demandé aux gouvernements tunisien et algérien d’expliquer les mesures qu’ils auraient prises pour transférer Slimane Bouhafs de la Tunisie vers l’Algérie, et les fondements juridiques de l’enquête pénale ouverte à son encontre à Alger.
Bien que des militants tunisiens des droits humains aient indiqué que le président Kaïs Saïed avait promis oralement le 3 septembre 2021 d’enquêter sur l’enlèvement présumé de Slimane Bouhafs, les autorités tunisiennes n’ont fait aucun commentaire public sur cette question.
L’Algérie a répondu aux experts des Nations Unies dans une lettre datée du 7 octobre 2021, en affirmant que des membres des forces de sécurité algériennes avaient arrêté Slimane Bouhafs le 27 août après qu’il avait tenté de louer une chambre d’hôtel sans présenter de documents d’identité à Tébessa, ville d’Algérie située près de la frontière tunisienne. Ayant trouvé sur lui des éléments le liant au Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK), ces agents l’auraient alors transféré à Alger, selon le même document.
Les autorités algériennes ont désigné le MAK comme organisation terroriste en mai 2021. Dans le même courrier, elles précisent les accusations retenues contre Slimane Bouhafs au titre de la législation algérienne. Selon elles, il aurait notamment publié des textes portant atteinte à l’État algérien, ses symboles et ses institutions ou faisant l’éloge du MAK, et communiqué avec des membres de cette organisation.
Cependant, les autorités algériennes n’ont fait aucun commentaire public sur la façon, le moment et les circonstances dans lesquelles Slimane Bouhafs est entré en Algérie.
« Un an s’est écoulé depuis que Slimane Bouhafs a disparu de son pays d’accueil avant de réapparaître détenu dans le pays qu’il avait fui, sans qu’aucun des deux gouvernements ne dise s’il y a été amené contre son gré », a déclaré Balkees Jarrah, directrice adjointe par intérim pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à Human Rights Watch. « Les autorités tunisiennes portaient la responsabilité, au regard du droit international, de protéger Slimane Bouhafs, mais aucun élément ne semble montrer qu’elles ont cherché à enquêter sur cette affaire et à demander des comptes aux personnes ayant violé ses droits humains. »
Les autorités algériennes ont refusé au moins quatre fois de le libérer provisoirement, selon sa famille et l’un de ses avocats.
Les autorités algériennes utilisent de plus en plus la définition excessivement large du terrorisme dans le Code pénal, que le président Abdelmadjid Tebboune a élargie par décret en 2021, pour poursuivre des militants et des défenseurs des droits humains, estiment Human Rights Watch et Amnesty International. Les autorités ont en outre récemment pris pour cibles d’autres voix critiques parmi la diaspora algérienne en prononçant des interdictions de voyager et des extraditions à leur encontre.
L’Algérie ainsi que la Tunisie ont ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), dont l’article 19 garantit le droit à la liberté d’expression. Toute restriction de ce droit doit être proportionnée et strictement nécessaire à la réalisation d’un objectif légitime.
En tant qu’État partie à la Convention de 1951 des Nations Unies relative au statut des réfugiés, à la Convention de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique et à la Convention contre la torture, la Tunisie est tenue de respecter le principe de non-refoulement, qui interdit les retours forcés, les expulsions et les extraditions de personnes réfugiées vers des pays où leur vie ou leur liberté est menacée et de toute personne vers des pays où elle risquerait d’être torturée. La Convention de 1951 interdit d’expulser des personnes réfugiées qui se trouvent légalement sur le territoire d’un État partie, sauf pour des motifs liés à la sécurité nationale ou à l’ordre public. Même dans ce type de cas, les décisions doivent être prises en conformité avec les procédures légales, « à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s’y opposent ».
Les articles 6 et 9 du PIDCP, garantissant les droits à la vie, à la liberté et à la sécurité, obligent les États à protéger les personnes vulnérables relevant de leur compétence, y compris lorsqu’elles sont réfugiées. Les autorités se doivent d’enquêter sur tous les cas de disparition forcée et d’amener les responsables présumés à rendre des comptes, selon les recommandations officielles du Comité des droits de l’homme de l’ONU sur l’application du PIDCP. Enfin, l’article 12 du PIDCP dispose : « Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. »